Table des matières
Ce qu’il faut retenir (pour les flemmards) :
- Une calorie = unité d’énergie, mais l’absorption et l’utilisation varient selon les aliments
- Dépense quotidienne = métabolisme de base + activité physique + digestion + thermogenèse
- Les formules de Mifflin-St Jeor sont les plus précises pour estimer les besoins
- Déficit calorique = perte de poids, mais avec adaptation métabolique progressive
- Le comptage aide à identifier les erreurs alimentaires, mais avec des marges d’imprécision importantes
Une calorie est une unité de mesure énergétique utilisée en nutrition pour quantifier l’apport et la dépense énergétique. Bien que le principe « calories consommées vs calories dépensées » soit fondamentalement correct, la réalité biologique est plus complexe que cette équation simpliste.
Définition et bases physiologiques
Une calorie représente la quantité d’énergie nécessaire pour élever la température d’un kilogramme d’eau de 1°C.
Dans l’organisme, cette énergie provient de trois macronutriments :
- Glucides : 4 kcal/g
- Protéines : 4 kcal/g
- Lipides : 9 kcal/g
- Alcool : 7 kcal/g
Les plus observateurs auront vu que c’est bien écrit kcal/g, factuellement 1 kcal (kilo-calorie) = 1000 calories. MAIS par abus de langage tout le monde dit « calories » pour les kcal. Dans cet article on utilisera donc cet abus par soucis de compréhension.
Ces valeurs correspondent à l’énergie brute mesurée par calorimétrie, mais ne reflètent pas l’énergie nette réellement utilisable par l’organisme.
Biodisponibilité des calories
L’absorption intestinale varie significativement selon la structure alimentaire. Par exempe, les amandes entières ne libèrent que 70-80% de leurs calories théoriques, contre quasi 100% pour les préparations broyées (Novotny et al., 2012).
Les fibres alimentaires réduisent l’absorption énergétique en « piégeant » une partie des nutriments et en accélérant le transit intestinal.
Donc lorsque vous voyez qu’un produit comporte X calories, en réalité vous en absorbez moins que cela, nous y reviendrons.
Dépense énergétique quotidienne
Ce que vous dépensez en calorie se nomme la dépense énergétique totale. Elle est composée de quatre éléments :
1. Métabolisme de base (BMR) – 60-70%
C’est l’énergie nécessaire aux fonctions vitales au repos : respiration, circulation du sang, synthèse protéique, maintien de la température corporelle…
Pour illustrer, c’est ce que vous dépenseriez si vous restiez allongé sans rien faire (mais vraiment rien) pendant toute une journée.
2. Activité physique – 15-30%
C’est tout simplement, toutes vos activités physiques de la journée, que ce soit du sport tout comme le fait de vous lever, de marcher, faire le ménager, vous doucher etc.
3. Effet thermique des aliments (TEF) – 8-10%
C’est l’énergie dépensée pour digérer, absorber, transporter et stocker les nutriments.
Le TEF varie considérablement selon les macronutriments :
- Protéines : 20-30% de l’énergie ingérée (Halton & Hu, 2004)
- Glucides : 5-10%
- Lipides : 0-3%
Cette différence explique en partie pourquoi les régimes hyperprotéinés facilitent la perte de poids : 100 kcal de protéines ne fournissent effectivement que 70-80 kcal nets après digestion.
4. Thermogenèse non-liée à l’exercice (NEAT) – 15-20%
Ce sont tous les mouvements involontaires : maintien de la posture, frissons, bouger le pieds lorsqu’on est assis…
Formules de calcul du métabolisme de base
Pour calculer votre métabolisme de base, de nombreuses formules existent, les plus précise sont les deux suivantes :
Mifflin-St Jeor (la plus précise selon les méta-analyses) :
- Hommes : BMR = (10 × poids kg) + (6,25 × taille cm) – (5 × âge) + 5
- Femmes : BMR = (10 × poids kg) + (6,25 × taille cm) – (5 × âge) – 161
Harris-Benedict révisée :
- Hommes : BMR = 88,362 + (13,397 × poids kg) + (4,799 × taille cm) – (5,677 × âge)
- Femmes : BMR = 447,593 + (9,247 × poids kg) + (3,098 × taille cm) – (4,330 × âge)
La formule de Mifflin-St Jeor présente une précision supérieure avec une marge d’erreur de ±10% contre ±15% pour Harris-Benedict (Frankenfield et al., 2005).
Apports énergétiques et balance calorique
Principe du déficit et du surplus
Déficit calorique : consommer moins d’énergie que les besoins = perte de poids Surplus calorique : consommer plus d’énergie que les besoins = prise de poids
Le déficit et surplus caloriques sont des règles absolues, c’est mécanique car on parle d’énergie (comme de l’essence dans une voiture).
Théoriquement, 1 kg de graisse corporelle équivaut à ~7700 kcal. Un déficit de 500 kcal/jour devrait donc générer une perte de 500g par semaine.
Réalité de l’adaptation métabolique
Cependant, cette règle linéaire ignore l’adaptation métabolique.
Lors d’un déficit prolongé, l’organisme réduit sa dépense énergétique de 15-25% au-delà de la simple perte de masse corporelle (Fothergill et al., 2016).
Cette adaptation peut persister des années après la perte de poids, nécessitant un effort permanent de 300-500 kcal quotidiennes pour maintenir le poids réduit (MacLean et al., 2018).
Pour maigrir, certaines personnes vont se mettre à faire plus de sport sans contrôler davantage leur alimentation. Le corps est bien fait et ajuste son apétit en fonction de l’effort. Ces personnes peuvent alors manger davantage ou des aliments plus calories de manière totalement inconsciente ! Au final elle ne perdrons pas de poids car elle ne seront pas en déficit malgré une dépense plus élevé.
Le corps peut aussi réduire les autres variables des dépenses caloriques. Je parle évidemment du NEAT (tous les mouvements inconscients) ! Sans vous en rendre compte, vous vous lèverez moins souvent, vous ne bougerez plus la jambes en étant assis etc. Ce qui pourra réduire votre dépense calorique après une grosse séance…
Donc il est important de garder en tête que le corps s’adapte et c’est normal ! C’est comme cela que l’Homme à pu évoluer au cours du temps. Heuresement, nous avons plusieurs outils nous permettant de contrôler ces paramètres aujourd’hui.
Le comptage des calories : utilité et limites
Intérêts du comptage
Le suivi calorique présente des avantages documentés :
- Prise de conscience alimentaire : identification des sources caloriques principales
- Détection des erreurs : portions sous-estimées, grignotages oubliés
- Objectivation des apports : remplacement des estimations subjectives par des données chiffrées
Une méta-analyse de 2011 montre que les personnes tenant un journal alimentaire perdent deux fois plus de poids que celles qui n’en tiennent pas (Burke et al., 2011).
À mon avis, tenir un journal (qu’il soit papier ou numérique) est une des meilleures méthodes pour perdre (ou prendre) du poids. Je sais que c’est très controversé et c’est pour cela qu’il faut être conscient des limites aussi.
Cependant, le processus de perte (ou prise) de poids doit être conscientisé et mener à des actions volontaires pour être efficace et quoi de mieux que de se rendre compte de ce qu’on mange réellement ?
Pour devenir meilleur les pro utilisent systématiquement des replays et enregistrement de leur match, pour se rendre compte des mauvaises et bonnes décisions et des actions à travailler, sans cette prise de recul l’évolution est très complexe.
C’est pareil avec l’alimentation ! Un journal permet de se rendre compte, que ce soit des grignotages, des plats riches en calories, de la quantité de légumes mangé sur une semaine etc. Rien que le fait de conscientiser vous aidera à y voir plus clair sur ce que chaque plat vous apporte et de mieux estimer les quantités.
Limites et marges d’erreur
Imprécisions des étiquetages : La réglementation autorise une marge d’erreur de ±20% sur les valeurs nutritionnelles déclarées (Jumpertz et al., 2013).
Erreurs d’estimation :
- Portions : sous-estimation moyenne de 25-40%
- Aliments riches en graisses : sous-estimation de 30-50%
- Restaurants : écarts de 200-300% par rapport aux valeurs déclarées
Applications et bases de données : Les applications utilisent des données moyennes qui ne reflètent pas les variations entre marques, préparations, ou degrés de maturité des aliments.
Montres connectées et capteurs d’activité
Les dispositifs portables surestiment massivement la dépense énergétique :
- Erreur moyenne : 20-40% de surestimation (Cadmus-Bertram et al., 2015)
- Activités de faible intensité : erreur pouvant atteindre 50-70%
- Calculs algorithmiques : basés sur des équations génériques inadaptées aux variations individuelles
Ces dispositifs sont plus utiles pour le suivi des tendances relatives que pour les valeurs absolues.
Recommandations pratiques
Usage intelligent du comptage :
- Période d’apprentissage : 2-4 semaines pour identifier les habitudes alimentaires
- Focus sur les tendances : éviter l’obsession des chiffres précis
- Attention aux aliments problématiques : identifier les sources de calories cachées
- Pause régulières : éviter la restriction cognitive chronique
Signaux d’alarme :
- Anxiété liée aux chiffres
- Évitement social lié à l’alimentation
- Rigidité comportementale excessive
Stratégies pour optimiser la balance énergétique
Gestion du déficit calorique
Déficit modéré : 300-500 kcal/jour pour minimiser l’adaptation métabolique
Diet breaks : périodes de maintenance calorique de 1-2 semaines toutes les 6-8 semaines pour « relancer » le métabolisme (Byrne et al., 2018)
Protéines élevées : 1,2-1,6 g/kg pour préserver la masse musculaire et maintenir le TEF
Optimisation de la composition alimentaire
Densité énergétique : privilégier les aliments à faible densité (légumes, fruits, protéines maigres) Index glycémique : favoriser les glucides à libération lente pour stabiliser la glycémie Timing nutritionnel : répartition des macronutriments selon les besoins énergétiques journaliers
Conclusion
Le concept de calorie reste un outil pertinent pour comprendre et gérer la balance énergétique, malgré ses limites inhérentes. La réussite à long terme dépend moins de la précision mathématique que de la compréhension des mécanismes adaptatifs et de l’adoption d’approches durables respectueuses de la physiologie humaine.
Le comptage calorique peut servir de phase d’apprentissage pour développer une intuition alimentaire plus précise, mais ne devrait pas devenir une contrainte permanente. L’objectif final reste l’autonomie alimentaire basée sur la reconnaissance des signaux physiologiques de faim et de satiété.
Références
Burke, L. E., Wang, J., & Sevick, M. A. (2011). Self-monitoring in weight loss: a systematic review of the literature. Journal of the American Dietetic Association, 111(1), 92-102. https://doi.org/10.1016/j.jada.2010.10.008
Byrne, N. M., Sainsbury, A., King, N. A., Hills, A. P., & Wood, R. E. (2018). Intermittent energy restriction improves weight loss efficiency in obese men: the MATADOR study. International Journal of Obesity, 42(2), 129-138. https://doi.org/10.1038/ijo.2017.206
Cadmus-Bertram, L. A., Marcus, B. H., Patterson, R. E., Parker, B. A., & Morey, B. L. (2015). Randomized trial of a Fitbit-based physical activity intervention for women. American Journal of Preventive Medicine, 49(3), 414-418. https://doi.org/10.1016/j.amepre.2015.01.020
Fothergill, E., Guo, J., Howard, L., Kerns, J. C., Knuth, N. D., Brychta, R., … & Hall, K. D. (2016). Persistent metabolic adaptation 6 years after « The Biggest Loser » competition. Obesity, 24(8), 1612-1619. https://doi.org/10.1002/oby.21538
Frankenfield, D., Roth-Yousey, L., & Compher, C. (2005). Comparison of predictive equations for resting metabolic rate in healthy nonobese and obese adults: a systematic review. Journal of the American Dietetic Association, 105(5), 775-789. https://doi.org/10.1016/j.jada.2005.02.005
Halton, T. L., & Hu, F. B. (2004). The effects of high protein diets on thermogenesis, satiety and weight loss: a critical review. Journal of the American College of Nutrition, 23(5), 373-385. https://doi.org/10.1080/07315724.2004.10719381
Jumpertz, R., Le, D. S., Turnbaugh, P. J., Trinidad, C., Bogardus, C., Gordon, J. I., & Krakoff, J. (2011). Energy-balance studies reveal associations between gut microbes, caloric load, and nutrient absorption in humans. The American Journal of Clinical Nutrition, 94(1), 58-65. https://doi.org/10.3945/ajcn.110.010132
MacLean, P. S., Higgins, J. A., Giles, E. D., Sherk, V. D., & Jackman, M. R. (2018). The role for adipose tissue in weight regain after weight loss. Obesity Reviews, 19, 15-27. https://doi.org/10.1111/obr.12755
Novotny, J. A., Gebauer, S. K., & Baer, D. J. (2012). Discrepancy between the Atwater factor predicted and empirically measured energy values of almonds in human diets. The American Journal of Clinical Nutrition, 96(2), 296-301. https://doi.org/10.3945/ajcn.112.035782
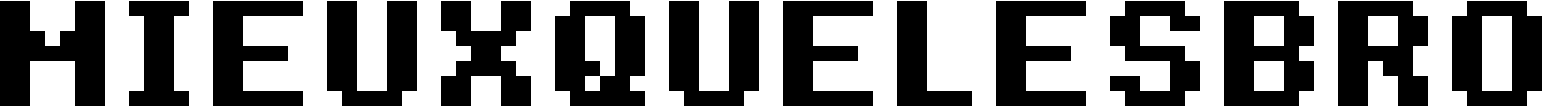
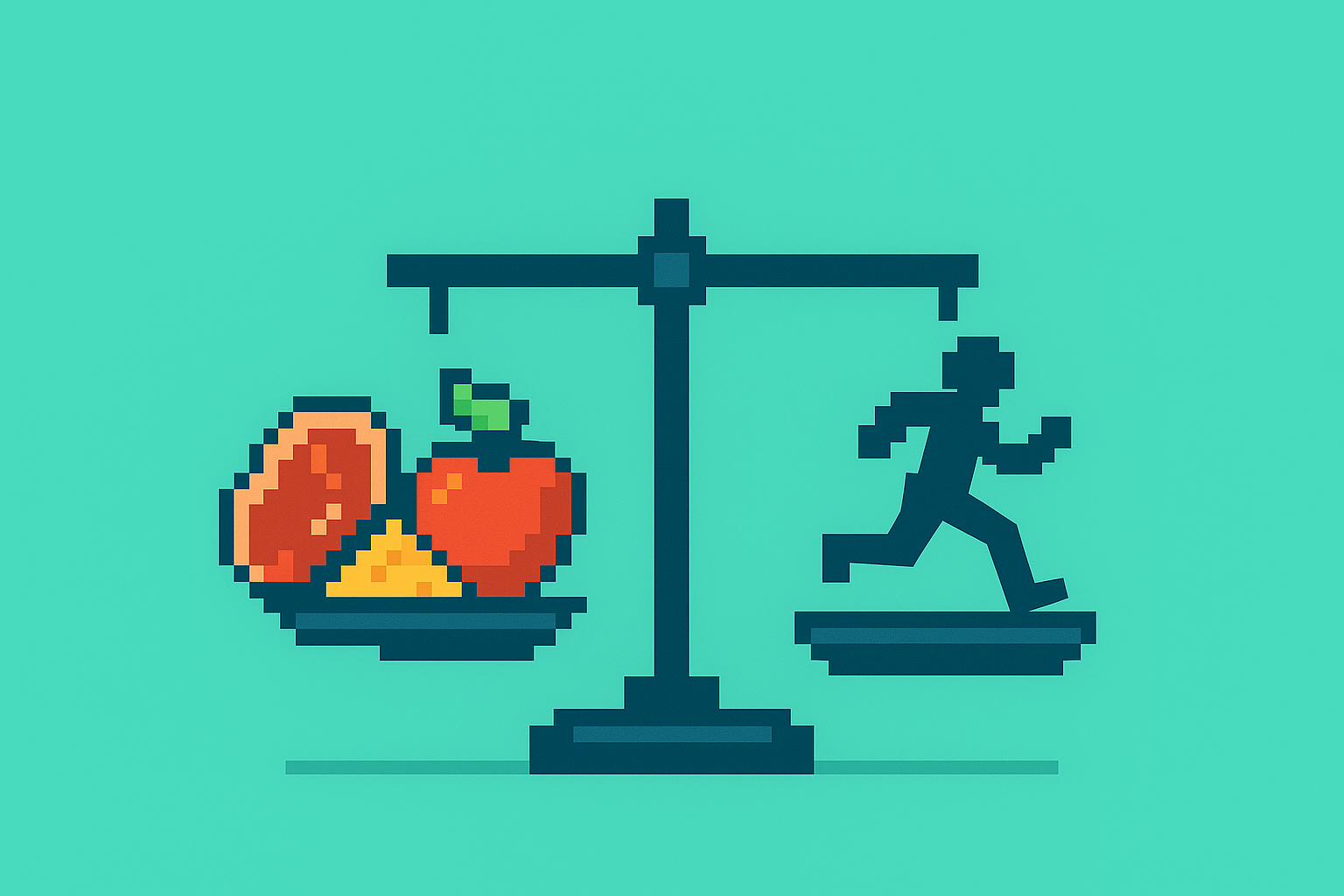
Laisser un commentaire